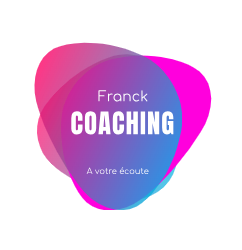LA CONSOMMATION D’ALCOOL EN FRANCE EN 2022
Ce bilan de l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) offre une vue synthétique de l’offre, des usages et des conséquences sanitaires et sociales de la consommation d’alcool en France pour l’année 2022.
FAITS MARQUANTS
Augmentation des volumes d’alcool pur mis en vente sur le territoire français (+ 1,9 % en 2022 par rapport à 2021), avec une progression importante des bières (+ 11,3 %).
En 2022, plus de la moitié des boissons alcoolisées vendues sont des vins (52 %).
Selon les données de l’enquête ESCAPAD 2022 portée par l’OFDT :
Un jeune de 17 ans sur cinq n’a jamais bu d’alcool dans sa vie et la part des jeunes ayant expérimenté l’alcool à cet âge est passée de 85,7 % à 80,6 % entre 2017 et 2022 (− 6 %).
Plus d’un tiers des jeunes (36,6 %) de 17 ans a effectué au moins une alcoolisation ponctuelle importante (au moins 5 verres standard en une occasion) dans le mois précédant l’enquête. Cet usage est cependant en diminution par rapport à 2017 (− 16,8 %).
Selon les données 2021 du Baromètre de Santé publique France, environ 80 % des adultes de 18 à 75 ans respectent les repères de consommation à moindre risque. Les consommations à risque sont davantage le fait des hommes (30,6 %) que des femmes (13,8 %). Diminution de 1,9 % des hospitalisations avec un diagnostic principal lié à l’alcool en 2022 par rapport à 2021, à population égale (227 794 séjours en 2022 contre 230 972 en 2021).
Diminution du nombre de bénéficiaires de traitements potentiellement utilisables pour l’alcoolodépendance en 2022 par rapport à 2021.
Le nombre de dépistages de l’alcoolémie sur les routes s’élève à 7 907 507 en 2022 et 759 personnes ont été tuées dans des accidents mortels avec alcoolémie positive du conducteur. Ces chiffres sont respectivement en baisse de 12,5 % et de 5 % par rapport à 2021.
Suite du bilan 2022
Augmentation des volumes d’alcool vendus entre 2021 et 2022 En 2022, les boissons alcooliques mises en vente sur le territoire français représentaient, en volume, environ 6 millions d’hectolitres d’alcool pur.
Ce volume d’alcool se répartit entre 52 % de vins, 25 % de bières, 21 % de spiritueux et le reste (moins de 2 %) sous forme d’autres boissons alcooliques (cidres, porto, etc.). Rapporté à la population française, ce volume de ventes correspond à 10,76 litres d’alcool pur en moyenne par an et par habitant âgé de 15 ans et plus, soit l’équivalent de 2,36 verres standard d’alcool par jour. Le volume d’alcool pur est en augmentation de 1,9 % par rapport à 2021 (passant de 10,56 à 10,76 litres d’AP par habitant en 2022).
Cette progression est principalement portée par celle des bières (de 11,3 % entre 2021 et 2022) et notamment des petites brasseries dont la production est égale ou inférieure à 10 000 hectolitres. La quantité de bière par habitant passe ainsi de 0,38 litre d’AP en 2021 à 1,17 en 2022. Depuis 2019, la vente de bières est d’une manière générale plus importante que celle des spiritueux (rapporté aux hectolitres d’AP mis en vente sur le territoire), ce qui n’avait jamais été le cas depuis le début des années 1960 jusqu’en 2018.
S’agissant des canaux d’approvisionnement, les ventes de vins tranquilles en grande distribution sont en baisse de 6 % par rapport à 2021. Ils sont vendus à 52,8 % dans les hypermarchés contre 33,7 % dans les supermarchés3 (FranceAgriMer, 2023). Ce sont les ventes de vins rouges qui ont été le plus en recul avec une diminution davantage marquée en volume qu’en valeur − contrairement aux vins rosés et vins blancs, qui sont également en recul en volume mais qui augmentent légèrement en valeur entre 2021 et 2022 (FranceAgriMer, 2023).
Quatre adolescents de 17 ans sur cinq ont déjà consommé de l’alcool en 2022 l’enquête montre que près d’un adolescent sur cinq (19,4 %) a déclaré n’avoir jamais bu d’alcool de sa vie en 2022, soit une proportion multipliée par trois en vingt ans.
Les niveaux d’usages de boissons alcoolisées en 2022 dans l’année ou dans le mois sont en baisse par rapport à 2017 parmi les jeunes de 17 ans (respectivement 73,3 % contre 77,7 %, et 58,6 % contre 66,5 %). Il en est de même des usages réguliers et des alcoolisations ponctuelles importantes, au moins 5 verres standard lors d’une même occasion. Il existe des différences de genre importantes. Par exemple, les garçons sont deux fois plus nombreux que les filles à déclarer des usages réguliers.
Pour rappel, 41 000 décès sont estimés attribuables à l’alcool en 2015, dont 30 000 décès chez les hommes et 11 000 décès chez les femmes, soit respectivement 11 % et 4 % de la mortalité des adultes de 15 ans et plus.
Ceci inclut 16 000 décès par cancer, 9 900 décès par maladie cardiovasculaire, 6 800 par maladie digestive, 5 400 par une cause externe (accident ou suicide) et plus de 3 000 par une autre maladie (maladie mentale, troubles du comportement, etc.) (Bonaldi et Hill, 2019). Évolution du recours aux soins
Les usagers d’alcool peuvent s’adresser à différents types de structures (hôpitaux, médecins de ville, structures médico-sociales spécialisées en addictologie, associations d’entraide).
Diminution du nombre de séjours en structure hospitalière En 2021, les séjours avec un diagnostic principal lié à l’alcool ont diminué de 1,4 % en volume et de 1,9 % à population égale par rapport à 2021 (40,6 séjours pour 10 000 habitants de 15 ans et plus en 2022, contre 41,4 séjours en 2021).

Suite et Fin
Cette évolution résulte principalement d’une tendance à la diminution des séjours pour intoxication alcoolique aiguë, amorcée depuis le début de la décennie 2010 et qui se poursuit entre 2021 et 2022 (passant de 14,7 séjours à 12,4 séjours pour 10 000 habitants).
Une légère baisse des séjours pour effets à long terme de l’alcoolisation s’observe également (6,3 séjours en 2021 contre 6,0 en 2022). Elle provient de la diminution des séjours pour les maladies du foie liées à l’alcool, qui passent de 18 300 à 17 800 entre 2021 et 2022. Comme pour les décès par cirrhose, cette baisse est considérée comme une des conséquences de la diminution de la consommation d’alcool amorcée en France à la fin des années 1960.
Baisse du nombre de personnes accueillies dans les CSAPA pour un problème d’alcool En 2022, environ 210 655 patients ont été pris en charge dans un CSAPA, dont 37 % l’ont été principalement pour un problème d’alcool (près de la moitié d’entre eux ayant été vus pour la première fois en 2022). Cette proportion est plus faible qu’en 2021, où le nombre de patients inclus dans le Recueil commun sur les addictions et les prises en charge (RECAP) au titre de l’alcool représentait 42 % de l’ensemble de la file active (203 078 patients). Les hommes continuent d’être largement surreprésentés parmi la patientèle prise en charge pour alcool en 2022 (77 %). Diminution des bénéficiaires de prescriptions de produits d’aide au sevrage de l’alcool
Différents médicaments peuvent être utilisés pour aider à l’arrêt prolongé de l’usage chez les personnes dépendantes à l’alcool. Les médicaments faisant l’objet d’une autorisation de mise sur le marché sont l’acamprosate, la naltrexone, le disulfiram, le nalméfène et le baclofène. La naltrexone et le baclofène peuvent être prescrits dans d’autres indications que le trouble de l’usage d’alcool. 7 Entre 2021 et 2022, le nombre de bénéficiaires4 d’un traitement pour alcoolodépendance a baissé pour l’ensemble des médicaments potentiellement utilisables. Cette baisse a surtout concerné le disulfiram (− 4,9 %), le baclofène (− 3,6 %) et le nalméfène (− 3,1 %).
Sources Observatoire français des drogues et des tendances addictives
Nous avons besoin de votre consentement pour charger les traductions
Nous utilisons un service tiers pour traduire le contenu du site web qui peut collecter des données sur votre activité. Veuillez consulter les détails dans la politique de confidentialité et accepter le service pour voir les traductions.